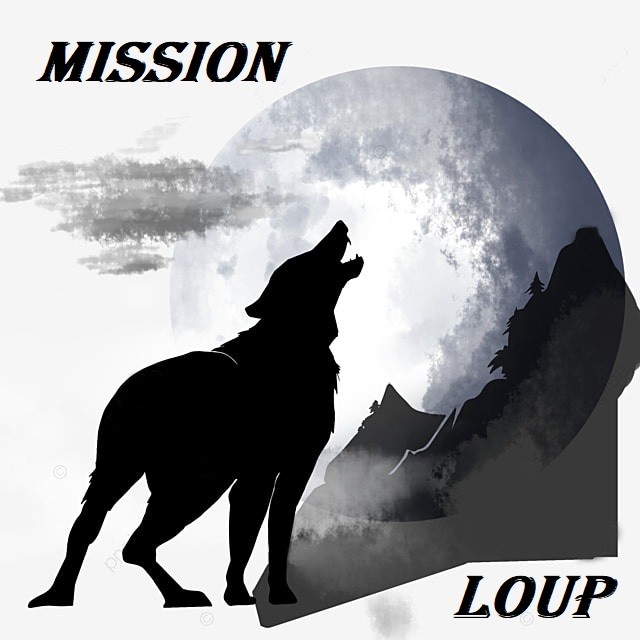Le 11 novembre dernier, dans le cadre de la régulation proactive de la meute du Mont-Tendre, un louve équipée d'un collier GPS a dû être achevée par les gardes-faune vaudois, après avoir été blessée lors d'un premier tir, la nuit du 5 au 6 novembre 2025. Elle était suivie dans le cadre du projet d'étude "Wolves and Cattles", piloté par le KORA, l'UNIL et la Direction Générale de l'Environnement vaudoise (DGE). Le 30 octobre 2024, elle avait été endormie sur le territoire de la meute du Marchairuz et équipée d'un système de surveillance pouvant fournir, toutes les 4 heures, des informations sur sa localisation. Le suivi a montré sa présence sur la France voisine, principalement en Franche-Comté, autour de Mouthe (Doubs), Mignovillard (Doubs) et Foncine-Le-Haut (Jura). Depuis peu, elle semblait être revenue dans le Jura Vaudois, sur l'ancien territoire de la meute du Risoud, aujourd'hui dissoute.
Son tir, qui a eu lieu sur le territoire de la meute du Mont-Tendre et dans le périmètre validé par l'Office Fédéral de l'Environnement (OFEV/BAFU), montre une recrudescence d'erreurs et de problématiques inquiétantes, qui se produisent sous diverses formes et dans plusieurs cantons. Nous tenons à les aborder, de manière plus approfondie, afin que la population comprenne la situation actuelle en Suisse.
L'établissement des périmètres de tir et leur validation
Le point noir de cette régulation proactive est sans conteste les périmètres de tir autorisés. En effet, en regardant dans les dossiers et le suivi des meutes, nous constatons qu'ils sont, bien souvent, beaucoup trop vastes, prenant en compte l'entier du territoire d'une meute. Or, scientifiquement, nous savons qu'il est impossible d'établir les limites claires et précises de territoires de meutes de loups, une espèce très mobile et dont les jeunes subadultes peuvent effectuer des excursions exploratoires. Il serait déjà judicieux de convenir que tout tir doit être proscrit sur les zones tampon (qui doivent impérativement être établies), périphériques ou encore sur des crêtes ou aux abords de rivières en délimitation de deux territoires. Aujourd'hui, les périmètres englobent ces zones là, ce qui conduit inévitablement à l'abattage d'individus n'ayant aucune filiation avec la meute, soit des disperseurs qui choisissent justement ces zones là pour traverser des territoires occupés, ou même des membres de meutes voisines, ce qui est plus grave.
Après deux phases de régulation proactive, nous pouvons analyser nombre de données et de faits, mieux comprendre les erreurs et leur provenance et affiner les paramètres dans l'établissement des périmètres, la sélection des meutes, des individus à réguler, entre autres. Mais malgré nombre d'erreurs, d'incohérences, de ratés, à ce jour les périmètres de tir restent les mêmes d'une année à l'autre, y compris lorsque des louveteaux de meutes non engagées dans la régulation se font abattre, une faute grave devant impérativement conduire à une réévaluation. Il incombe donc aux autorités fédérales et cantonales de prendre les mesures qui s'imposent et d'apporter systématiquement un examen plus approfondi des données globales disponibles, pré et post régulation.
Dans le cas du Jura vaudois, où les meutes ont quasiment systématiquement à leur tête un membre issu des meutes voisines, l'établissement des périmètres de tir doit être analysé de manière encore plus pointue, en limitant systématiquement les périmètres de tir. La "tolérance" est plus grande sur les zones tampon, qui peuvent, elles aussi, être plus vastes. La population doit, elle aussi, comprendre qu'au vu du fonctionnement de l'espèce canis lupus, il y aura toujours des disperseurs qui pourraient perdre la vie en traversant des territoires de meutes engagées dans la régulation proactive ou réactive. Nous ne considérons pas cela comme une erreur en soi, c'est plutôt une problématique qui est malheureusement en lien avec la dynamique de dispersion, la nécessité de trouver des territoirs libres et de devoir, pour se faire, traverser des territoires occupés, ce qui engendre de gros risques pour l'intégrité du jeune loup. Il peut mourir certes d'un tir régulatoire mais également être attaqué par la meute locale, en passant sur son domaine vital.
Existe-t-il des solutions pour tenter d'éviter le tir d'individus non reliés génétiquement à une meute régulable ou de membres de meutes voisines ? Oui, il en existe au moins deux : assurer un suivi approfondi, en collaboration avec d'autres entités, pour avoir plus de données/interactions et restreindre drastiquement les périmètres de tir, pour éviter les zones tampon ou à risque ! Cela est assez logique mais nous constatons, surtout en 2025 dans les dossiers de certains cantons, qu'elles ne sont pas appliquées ou prises en compte puisque l'OFEV/BAFU valide des périmètres de tir faisant la totalité des territoires de meutes, une aberration scientifique certaine. Quant au suivi, il est loin d'être suffisamment approfondi et la transparence est loin, elle aussi, d'être totale sur les données récoltées. Le contenu des dossiers de demande de régulation devient, d'ailleurs, de plus en plus sommaire et laconique, rendant impossible le pointage des données pour s'assurer de leur justesse. Et au vu du nombre assez grossier d'erreurs de tir, de fautes graves qui sont passées inaperçues, il est clair que quelque chose ne fonctionne pas ou plus. Or, lorsqu'on parle de réguler une espèce, protégée de surcroît, soit des êtres vivants, il est impérieux, obligatoire, de fournir un maximum de données et d'analyses approfondies. Elles devraient être pointées par plusieurs organismes, possédant les leurs propres et non en contrôlant seulement celles d'une unique source étatique, fonctionnant en circuit fermé. Ainsi, il serait possible d'optimiser la compréhension du fonctionnement de chaque meute et de prendre des décisions adaptées.
En prenant en compte l'ensemble des données génétiques de ces cinq dernières années sur plusieurs meutes valaisannes, nous avons effectué un travail afin de démontrer en quoi une une diminution des périmètres de tir pourrait permettre d'éviter nombre d'erreurs de tir. C'est assez révélateur et simple à appliquer.
Communication, évaluation et correction
Dans le cas de cette louve, F259, il conviendra désormais d'analyser les données récoltées par le KORA, grâce au collier GPS, sur les derniers jours de sa vie. Il est nécessaire de comprendre pourquoi la présence d'une femelle adulte, avoisinant le territoire d'une meute ayant perdu quasiment tous ses membres depuis août (dont la femelle reproductrice) et sur lequel reste le mâle reproducteur libre (M351), n'a pas mené à des évaluations sur la possible/probable évolution de la situation, en mettant en avant un principe de prudence. En effet, on ne peut nier le risque élevé que cette louve soit tentée de rejoindre, dans ce contexte précis, le mâle reproducteur se retrouvant sans partenaire, possiblement seul, dans une phase de dispersion reconnue et importante. En Valais, certaines femelles ayant perdu leur mâle entre septembre et début novembre, ont mis moins d'un mois avant de retrouver un partenaire ! Cela démontrerait l'efficacité de la dispersion à cette période automnale, propice à la fondation de nouvelles meutes. Au vu du suivi GPS, il aurait peut-être été recommandé de stopper, momentanément, les tirs afin d'observer le comportement de F259, puisqu'elle est au coeur d'une étude scientifique importante. Ou au minimum de procéder à une réduction du périmètre de tir, afin d'éviter les zones tampon et limitrophes sur lesquelles un loup/une louve solitaire choisit souvent de passer ou de procéder à des excursions exploratoires. Ce territoire est aujourd'hui presque vide, la grande majorité de la meute du Mont-Tendre a désormais passé de vie à trépas.
Il semblerait qu'autant en amont qu'en aval, les conséquences des tirs régulatoire (proactifs ou réactifs) sur un individu ou une meute ainsi que les connaissance sur l'espèce ne mènent visiblement pas à une réflexion et à des analyses approfondies. Cette absence d'évaluation des autorités et organismes en charge du suivi des grands prédateurs est particulièrement critiquable et démontre à quel point ces dernières avancent quasiment à l'aveugle, consultant la politique mais aucunement la science. C'est une aberration lorsque des décisions concernant la gestion d'êtres vivants, de la nature, où tout est évolutif par définition et doit être constamment (ré)évalué !
Voici quelques erreurs constatées depuis 2023 et qui n'ont, à ce jour, pas donné lieu à une quelconque communication ou modification claire par les autorités, autant cantonales que fédérales :
Des meutes n'ayant pas commis de dégâts, ou seulement une ou deux annuellement en situation protégée, sont engagées dans la régulation totale ou partielle (2/3 des louveteaux de l'année).
Des louves reproductrices sont abattues en plein été, au travers de la régulation réactive. Pour rappel, c'est une période cruciale dans le nourrissage et l'éducation des louveteaux. Ces femelles, une sur Vaud et une autre en Valais, ont été soit confondues avec le mâle reproducteur, qui devait être le seul loup abattu, ou pire encore, sont labellées comme "individu solitaire" (signature de la demande de tir et régulation en moins de quatre jours chrono) alors que nombre de données des autorités prouvent, sans aucune contestation possible, la présence de deux individus déjà en hiver 2025 (soit six mois avant le tir).
Des loups adultes sont abattus entre septembre et octobre, période où il est impossible de ne pas voir la différence significative de gabarit entre les jeunes et les adultes. Aujourd'hui, ce type de tir est reconnu comme étant un non respect des lois puisque l'Ordonnance (OChP) mentionne clairement l'obligation de prélever les louveteaux en premier ! Les propos de certains services étatiques ne relatent donc pas la réalité. Il y a fort à parier que nombre de loups sont abattus dès qu'ils passent devant le fusil, sans la présence de la meute entière, ce qui est pourtant une obligation afin de pouvoir différencier les gabarits et morphologies (y compris au travers de l'éthologie --> postures, mimiques, comportements, etc.). Une erreur aux conséquences potentiellement très négatives et qui ne respecte pas les articles de la Loi et Ordonnance sur la chasse.
Des autorisations de tir sont délivrées alors que certains dossiers des autorités cantonales (Valais) sont lacunaires, pour ne pas dire totalement vide pour l'un d'entre eux. L'examen pourtant obligatoire du DETEC et du KORA doit l'être tout autant pour ne pas voir les erreurs flagrantes et l'absence de données de qualité et en nombre suffisant en ce qui concerne le suivi de ces meutes, ce qui est contraire à l'Article 11 de la directive "Habitats" (Directive 92/43/CEE). Cette dernière doit être respectée au niveau européen, la Suisse ne faisant pas exception.
Le tir d'individus de meutes voisines, non concernées par la régulation, de loups équipés de matériel d'étude (F259) ou encore d'autres espèces que canis lupus (un chien de protection et trois lynx ont déjà été des dommages collatéraux) montrent l'impossibilité, avec la formation actuelle et le nombre de tirs à effectuer, de procéder de manière plus sécuritaire.
Plusieurs tirs ont blessés des loups, nécessitant la mise en place de recherches avec des chiens de sang, sans que tous les cas aient pu être retrouvés ou des explications fournies publiquement sur la santé de l'animal. Dans le cas de F259, il s'est écoulé plus de cinq jours entre le moment du tir et la mort de l'animal, qui a dû être achevé au vu de la gravité de ses blessures. Et ceci alors qu'elle n'était pas concernée par la régulation ! Bien qu'il soit difficile, y compris avec du matériel thermique, de viser un animal quasiment toujours en mouvement, ces erreurs sont également un point qui doit être discuté, travaillé, rapidement. L'autorisation accordée aux chasseurs de participer à la régulation, alors que certains ne sont pas entraînés ou habitués à chasser de nuit, nécessite des approfondissement et un encadrement certain. Notamment au travers d'une formation bien plus professionnelle et complète que celle distillée actuellement et basée également sur l'éthologie. Pour rappel, en Suisse, un permis de chasse conventionnel s'obtient après trois ans de formation théorique et une connaissance approfondie de la biologie et des comportements des espèces chassables. Ca n'est clairement pas le cas pour le loup !
Les questions qui brûlent toutes les lèvres sont les suivantes : les autorités cantonales et fédérales toléreraient-elles autant d'erreurs lors de la chasse de gibier conventionnelle ? Trouveraient-elles normal et éthique d'abattre une biche ou une chèvre de chamois en plein mois de juillet/août, laissant alors le faon/cabri seul ? Accepteraient-elles que des espèces ou individus ne pouvant être chassés ou sortant des quotas fixés, soient tirés quand même, sans sanction aucune ? Seraient-elles OK de délivrer des permis de chasse pour du cerf, du renard ou tout autre animal avec une simple "formation" accélérée de trois heures qui ne permet aucunement de maîtriser la connaissance obligatoire d'une espèce telle le loup, qui est complexe, évolutive et tournant autour d'une dynamique sociale éminemment importante et devant absolument être maîtrisée ? La réponse est évidemment non, cela ne serait pas toléré ni accepté. Pourtant, toutes ces erreurs ou dérives, qui ne sont pas toutes détaillées ici, sont bien présentes dans la régulation du loup, sans que cela ne semble déranger personne dans les sphères étatiques et fédérales...!
Le manque ou l'absence de communication, de transparence, de collaboration plus active, laisse songeur et montre que nombre de points doivent être améliorés, urgemment. La façon dont la gestion du loup a été appliquée en Suisse depuis 2023 est contraire à certaines exigences des lois européennes, comme le montre la récente plainte contre la Suisse pour sa gestion du loup, validée par l'UICN/IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature).
Une politique qui mord à côté - comprendre les erreurs de la régulation en Suisse - Partie 2
Article : Team Mission Loup
Photo : KORA (F259 lors de la pose du collier GPS) & Mission Loup